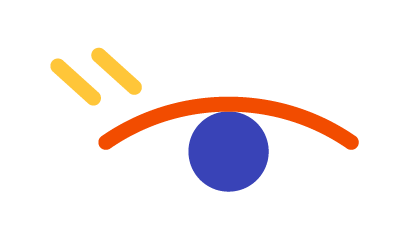LE CREPUSCULE DES INFLUENCEURS ECOLOS
On annonce pour la rentrée une coupure de dix minutes consacrée notamment à des influenceurs écolos dans l’excellente émission La Terre au Carré de France Inter. C’est le moment de questionner le rôle des influenceuses et influenceurs dans la perception de l’écologie. Entre journalisme, show médiatique, lanceurs d’alerte, et déni de politique, les influenceurs cultivent un entredeux flou. C’est assez paradoxal quand on s’affiche au quotidien. Quelle est leur vraie place, et que veulent-ils ?
La vague des influenceurs.euses en écologie est née avec la figure militante de Greta Thunberg en 2018. Greta devient rapidement une icône écolo, face à l’inaction climatique des gouvernements. Son écho médiatique immense ne lui a enlevé ni sa radicalité, ni une vraie modestie dans la conscience de l’impact de ses actions. A sa suite, on a vu naître en France les porte-voix de causes environnementales diverses. La question est de savoir ce qui rend service à l’écologie : avons-nous besoin d’être « influencés », informés ou convaincus ? Le sujet est-il de contribuer seulement à la démocratie d’opinion, ou de construire un projet de société ?
Dans le réel l’influenceur est une figure assez solitaire. Ce n’est pas un leader d’opinion car il ne défend pas une pensée originale, mais il relève du monde du spectacle par la mise en scène de ses propos. Et il réclame de l’attention : l’influenceur a un public qui attend de lui une sorte de show. La loi exigeante de l’image sur les réseaux sociaux fait que son âge, son look ont une valeur égale à la teneur de son discours. C’est un performeur de lui-même. Mais il y a un risque, c’est que la notion d’image le fige peu à peu dans un rôle récurrent. Sa jeunesse est parfois mise en avant, comme un véritable produit d’appel. Mais n’est pas porte-parole de la jeunesse qui le veut, pour une raison simple : c’est que l’âge avance. Les besoins changent, les perceptions changent. Cela nécessite de se renouveler et d’évoluer à son tour. Et c’est un exercice délicat quand on est installé sur des certitudes, et une image.
L’influenceur a donc des convictions qu’il rapporte et partage en public, mêlant journalisme et un côté hâbleur.
Et que veut donc l’influenceur ? Quelque part l’influenceur voudrait avoir un poids politique, mais sans faire de politique avec les risques de rejet, de changement de casquette que cela implique. En réalité l’influenceur échoue à créer une alternative au système politique. Il crée dans le meilleur des cas une communauté supplémentaire aux nombreuses qui naissent et disparaissent. Enfin cette image auto-centrée peut aller jusqu’à un parfum de narcissisme, totalement hors-sujet.
Cette attitude a les avantages et les faiblesses de son positionnement. Parfois c’est hype, d’autre fois donneur de leçons, ou verse dans l’auto-justification. La question de l’avenir de cette position se pose. Car une frontière existe vraiment entre le maniement d’un médium d’influence, et un réel projet de société. Par exemple, contenir le réchauffement climatique à 1%5 ne constitue en rien un projet de société, c’est une nécessité. La sobriété comme mot d’ordre ne suffit pas non plus, pour les mêmes raisons. Il arrive même que ces injonctions laissent croire qu’avant c’était mieux… puisqu’on veut y revenir. Non, avant ce n’était pas mieux. Un sujet politique au sens noble du terme, c’est déclarer nettement un projet pour le futur. On ne parle pas ici de dystopie, mais d’une vision de la société. Refuser le positionnement politique c’est aussi refuser l’avenir, ne pas contribuer à le dessiner malgré les apparences. C’est prendre le rôle d’arbitre auto-proclamé et compter les points en public. Mais l’enjeu qui nous intéresse est de prendre notre destin en main, individuellement et collectivement. Notre avenir n’est pas de suivre des « sauveurs. » Aux mots, aux postures habiles issues souvent des codes d’une société consumériste qu’on critique justement par ailleurs, on est en droit de préférer ceux qui agissent. Si nul n’est exempt de contradictions, les françaises et français qui mettent l’écologie au 2ème rang de leurs préoccupations ne trouvent pas dans l’influence une réponse solide à leur quotidien. Les citoyens sont plus exigeants et lucides qu’il n’y paraît. A terme, le rôle des influenceurs écolos devra évoluer, muter ou se noyer dans la répétition.
Pour durer il faudra développer une pensée en propre, originale. Ce ne sera pas une écologie des 1001 solutions, régie par les rapports, les mots d’ordre et les anathèmes. Bref, un chemin tout tracé. Ce sera un projet de société. Les coups d’éclat, les vidéos un peu cash n’ont d’impact réel et durable que si le fond est là, et si ne nous sommes pas surpris que par la forme. Ce que Greta a d’ailleurs fort bien compris, avec la profondeur qui lui est propre. Ce qui se joue, c’est le défi d’une écologie vraiment populaire, c’est-à-dire partagée.
Il faut ouvrir un nouveau temps de l’écologie, insérée dans un projet social. Une vision qui au lieu de fractionner en communautés, en segments d’âge ou de culture, s’adresse à une majorité et pas à des particularités renforcées par les algorithmes. La lecture communautariste, et de quelque extrême qu’elle vienne, n’est qu’un essai infirme de captation du pouvoir. L’action écologique a besoin à la fois de plus de modestie, et de plus d’ambition. Modestie pour écouter, accueillir et écouter les peurs liées au changement climatique. Ambition pour dessiner l’avenir et engager la société. Une écologie qui rassemble des âges, des cultures multiples, des sentiments très divers -parfois ambivalents, voire contradictoires- est une écologie de l’avenir. On ne réussit pas qu’avec des convaincus, mais aussi avec des femmes et des hommes qui espèrent. Qui font confiance.
Il en est une valeur qui subordonne toutes les autres : on ne fait pas un projet de société sans amour. C’est peu dire que le discours écologique actuel, à quelques rares exceptions près, manque souvent d’empathie et d’amour. Non, pas seulement l’amour de la planète. Mais l’amour de ses semblables qui est la base d’un projet de société véritablement social, solidaire et engageant. Elle raisonne encore trop.
Patrick SCHEYDER, pianiste et auteur, concepteur de spectacles, cofondateur du mouvement de l’Ecologie culturelle
Nicolas ESCACH, maître de conférences en géographie, directeur du Campus des Transitions de Sciences Po Rennes à Caen, cofondateur du mouvement de l’Ecologie culturelle
Thomas MARTIN et Noémie JOLLY, fondateurs du média ECOTALK