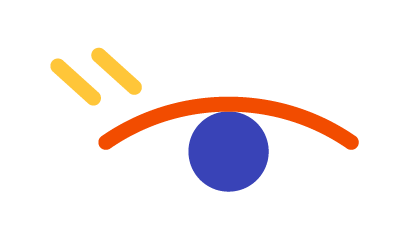Par Nicolas Escach, directeur du Campus des Transitions (Sciences Po Rennes), cofondateur de l’Écologie culturelle.
Backlash, repli, recul, nous nous trouvons à un moment déterminant de la transformation écologique. Nous manquons d’espaces publics pour poser ses enjeux et nous positionner collectivement pour redéfinir nos valeurs et nous orienter, quel que soit le scénario choisi. Un temps et un espace partagés seraient plus que nécessaires pour prendre le contrepied d’une polarisation de plus en plus grande entre ceux qui attendent la bascule avec inquiétude et ceux qui s’en éloignent. Le tout dans un bruit de fond réactionnaire. Nous pensons fermement que l’Écologie culturelle peut être une réponse à ce retour en arrière et que les transitions souffrent de ne pas avoir été placées au bon niveau : celui d’une refonte sociétale et démocratique qui réconcilie notre histoire et notre géographie.
Renouer avec l’Écologie populaire
Devant le vertige climatique, la tentation est grande de céder aux sirènes de la bureaucratie ou de la technocratie : une politique en boucle sur elle-même ou une politique déléguée aux seuls experts. Bien sûr, nous avons besoin d’indicateurs et de graphiques, mais une société désire autre chose que des degrés Celcius.
L’Écologie culturelle s’intéresse à l’espace laissé vide entre l’écologie politique et l’écologie scientifique. Elle embrasse le politique au sens le plus large du terme. Grâce à elle, l’écologie est mise à la place qui est la sienne : un projet de société qui interroge nos identités, nos citoyennetés, l’hospitalité et le vivre ensemble. Faire Nation et faire commune par l’écologie suppose de défendre une écologie ascendante et non descendante, une écologie qui part du terrain, de l’intimité et du sensible.
L’écologie s’est coupée de sa dimension populaire dans les années 1970-1980. L’Écologie populaire ne doit pas être enfermée dans un type de quartier ou dans des discours communautaires. La France populaire n’a pas de limites et est partout : dans les espaces ruraux, les zones isolées, les cœurs précarisés des métropoles, les espaces périurbains ou rurbains, aussi bien que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les bourgs et les tours partagent les mêmes problématiques : un sentiment de déclassement, une dépendance à l’automobile, un problème d’accès aux services publics et à l’emploi. L’Écologie populaire est avant tout une écologie pour tous, même si elle ne dit pas son nom. Elle s’inscrit dans des pratiques ordinaires : covoiturage, réemploi, réparation, cuisines collectives. Renouer avec l’Écologie populaire suppose avant tout de recréer une communauté de destin à travers une dimension intégratrice : Victor Hugo n’avait pas d’autre projet quand il donnait une voix à la Nation et au Peuple.
Réconcilier écologie et libertés
L’écologie injonctive et punitive ont conduit à opposer écologie et libertés à l’échelle individuelle. L’Écologie culturelle défend au contraire l’écologie comme outil d’émancipation et de maturité, mais aussi comme voie vers une restauration du pouvoir d’agir et vers une plus grande autonomie en mobilisant l’ensemble des intelligences (analytique, sensible, intuitive, corporelle). Nous avons besoin de nouvelles lumières au sens humaniste, avec une perspective élargie au vivant non humain.
Cessons de confondre progrès humain et progrès technique : passons de l’adolescence à la maturité en développant nos compétences, nos lucidités et en aiguisant notre regard.
La liberté, nous semblons à première vue en manquer également en tant qu’élus locaux : des crises à répétition, des mesures qui doivent parfois être prises dans l’urgence, des budgets réduits à la portion congrue, des coûts de l’énergie en hausse, des assurances qui renégocient leurs contrats, des habitants qui expriment des projections et des injonctions contradictoires, une confiance qui reste forte pour l’élu local mais qui s’érode en ce qui concerne la politique de manière générale, une complexité accrue du régime de décision.
S’ajoutent à cela des études accablantes : le climat n’arrive qu’en queue de liste des enjeux déterminants pour les prochaines élections s’effaçant derrière la sécurité des personnes et des biens (le lien au climat serait pourtant naturel), la bonne santé financière, l’offre de soin et les services de santé.
Décider autrement
Nous plaidons face à ces défis pour une évolution de ce qu’est décider. Décider ne s’incarne plus dans des solutions prêtes à l’emploi, dans une démonstration de la maîtrise absolue ou dans une forme d’infaillibilité, quand bien même nous devrons rendre des compte de nos actions et de nos inactions, humainement et juridiquement.
L’élu doit apprivoiser sa sensibilité et l’ensemble des intelligences stratégiques, apprendre à ouvrir le champ de la délibération. Il doit mettre son action à un niveau sociétal et culturel.
Nous parlons d’orientation collective comme premier pas : une orientation est éminemment culturelle, elle passe par des cartes, un regard porté au patrimoine, un éveil au vivant non humain, des immersions artistiques. L’orientation sort de l’action figée des seuls programmes, projets, plans, parfois utiles mais non suffisants. L’orientation appelle d’autres démarches : des expériences individuelles et collectives, des formes de synchronisation, une coévolution entre les habitants et leurs espaces de vie et des actualisations régulières. Plutôt que l’urgence, il est urgent de choisir la pause, d’opérer des formes de décélération.
Nous pouvons citer deux exemples concrets et récents. La cérémonie d’ouverture des JO a eu, par la dimension artistique et une forme de synchronicité (d’ailleurs promue par Thomas Jolly lui même), une portée territoriale et sociétale : bien qu’elle ne change pas à court terme l’ensemble de nos pratiques, elle a dessiné un horizon d’attente vers lequel converger et qui constitue un référentiel mobilisateur. Elle a aussi consacré la Seine comme centralité.
La redirection du quartier de la Presqu’île à Caen donne lieu elle aussi à une nouvelle manière de faire la ville avec une contribution active du Bazarnaom et du collectif Presqu’île Créative à travers sa place imaginaire. Le Millénaire est l’occasion pour les Caennais de redécouvrir tout un espace renaturé le long des berges. Paradoxalement, ne pas forcément construire invite à l’accueil des initiatives. La politique locale invite et reçoit.
L’Écologie culturelle, un outil opérationnel
L’Écologie culturelle lutte contre l’instrumentalisation de l’art pour activer un nouveau quartier ou dynamiser l’espace public. Avec le changement climatique, nous parlons de changements majeurs, systémiques, qui vont nous faire perdre nos repères au sens littéral du terme : des espaces qui se dérobent sous nos pieds, un espace réduit, des centralités qui changent de localisation, des maisons où nous avons passé une grande partie de notre vie qui sont réduites en fumée.
La culture est la seule voie qui se situe au bon endroit pour traiter ces enjeux et éviter le déni : elle appelle à travailler le rapport à la propriété, à la transmission, à nos racines, à la centralité, au vivre ensemble, à imaginer un autre rapport à l’espace.
Ce n’est pas un hasard si les grandes mutations de territoires ont exigé une place centrale des artistes : la fermeture des usines de la Ruhr ou du Nord-Pas-de-Calais a amené à une réflexion culturelle et artistique. Les friches font d’ailleurs l’objet depuis les années 1980 d’une redécouverte de la biodiversité et de réappropriations culturelles.
Combattre le recul écologique suppose de rendre l’écologie désirable dans un cadre qui ne peut être que démocratique. Les chocs à venir affecteront nos corps et notre intimité. Bâtissons dans chaque territoire et à l’échelle nationale une pensée pratique et un artisanat de l’action qui prenne soin de chacun. Tissons des liens entre défis sociaux et environnementaux pour que les uns répondent aux autres. Par l’écologie conviviale et solidaire, osons individuellement et collectivement l’avenir.